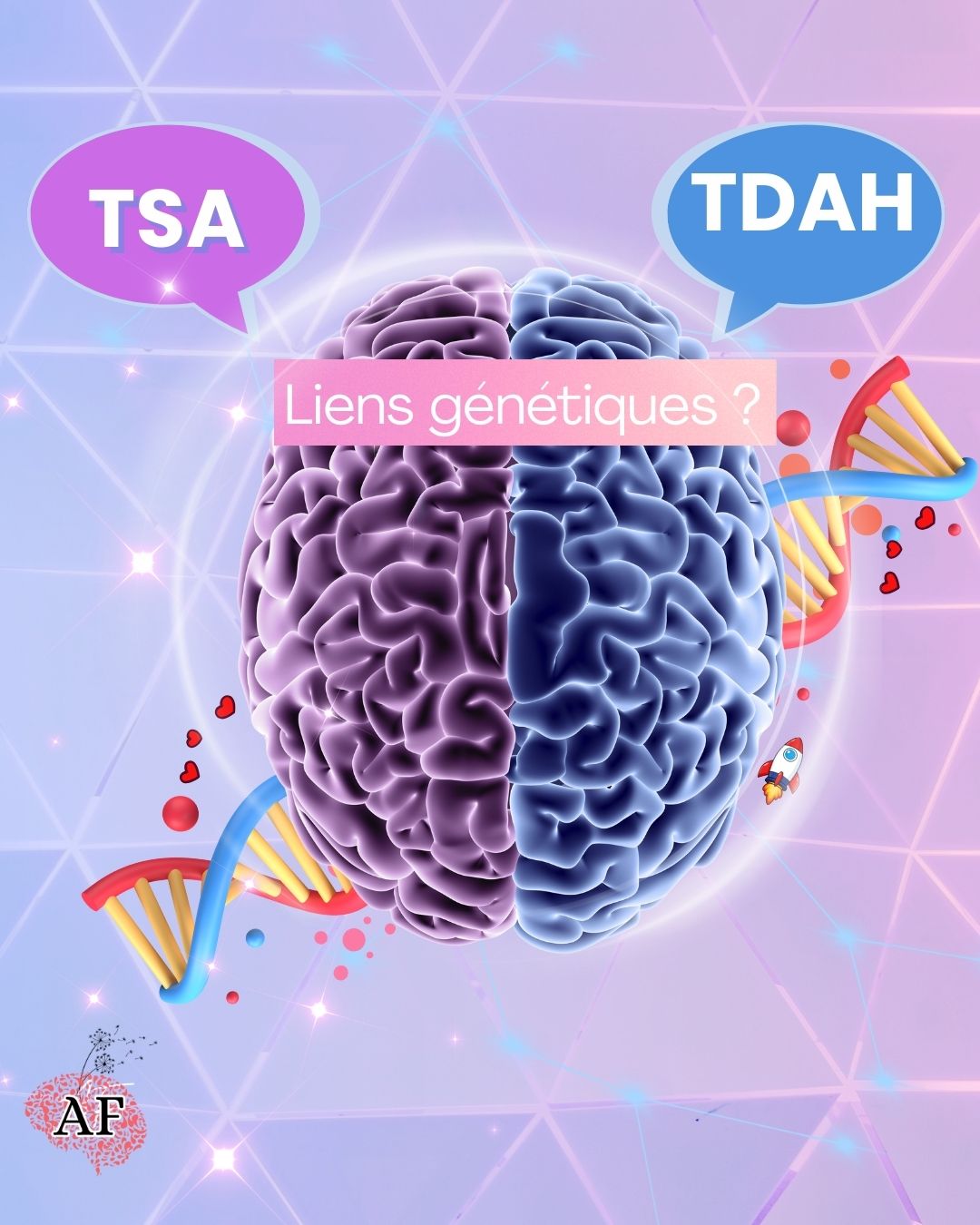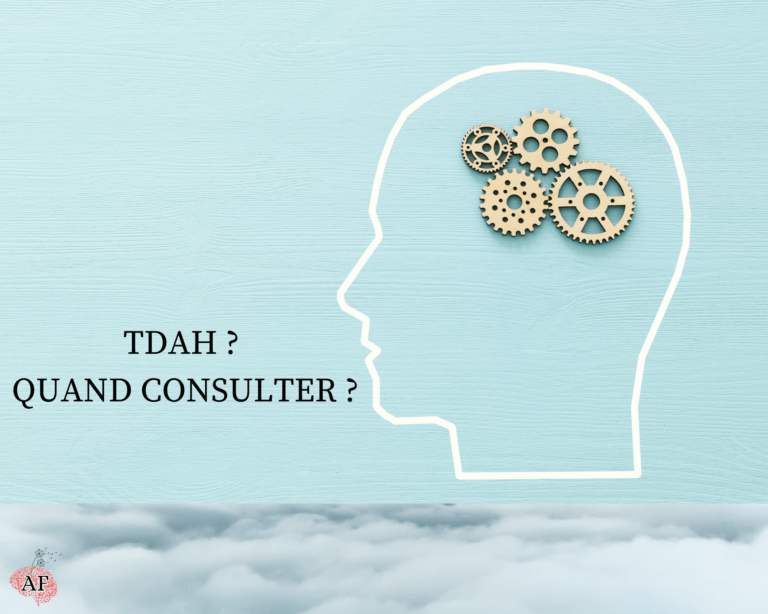TDAH et Autisme : Quels sont les liens génétiques ?
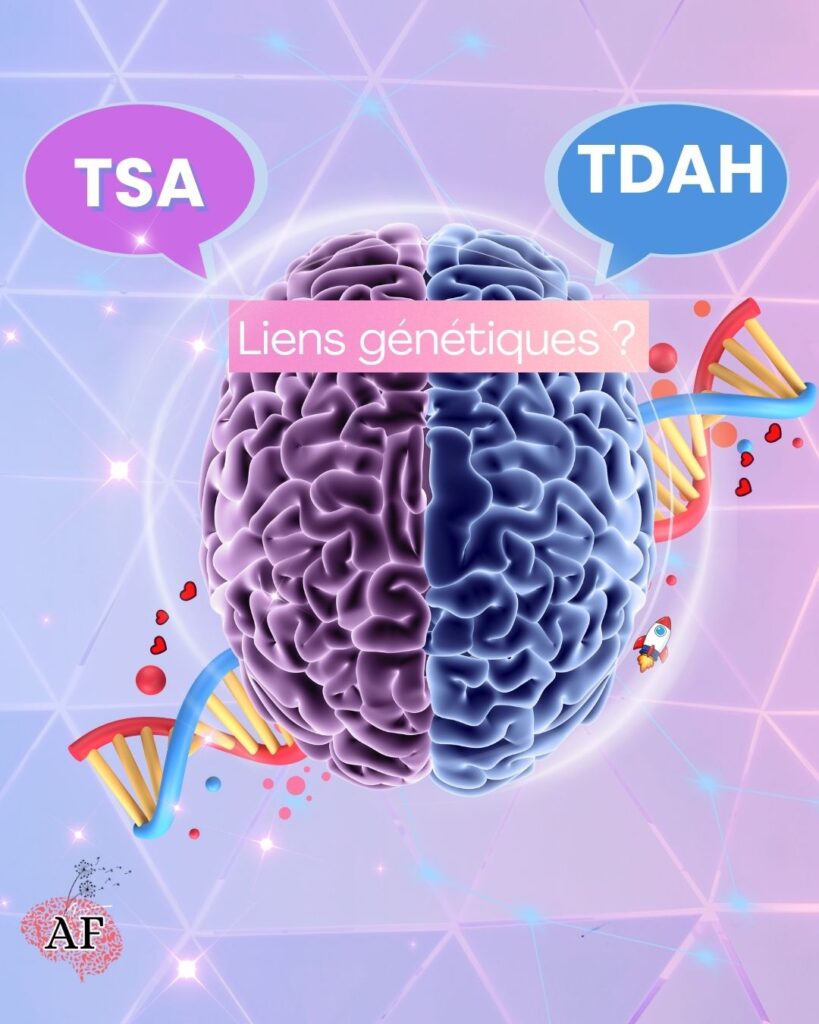
TDAH et Autisme : Quels sont les liens génétiques ? En tant que famille neuroatypique, nous avons été amenés à réaliser des tests génétiques, ce qui a naturellement inspiré cet article. On se pose spontanément la question de la génétique : y a-t-il un lien ? Et parfois, on peut même ressentir une forme de culpabilité en se demandant si les troubles du neurodéveloppement de notre enfant sont, en partie, « de notre faute ». C’est pour explorer et mieux comprendre cette question que j’ai mené cette exploration sur l’impact de la génétique. Enfin, comprendre les bases génétiques aide à mieux appréhender ces troubles et à lever la culpabilité.
TDAH et Autisme une question d’hérédité ?
Table des matières
Le TDAH : une forte composante génétique
Des études sur les jumeaux estiment l’héritabilité du TDAH à environ 76 %, ce qui signifie que la génétique joue un rôle majeur, mais n’est pas le seul facteur déterminant. Des facteurs environnementaux entrent également en ligne de compte. Il est crucial de souligner que les personnes touchées par le TDAH ne sont pas le résultat d’une « mauvaise éducation » ou d’une consommation excessive de sucre ; il s’agit d’une condition neurobiologique.
Les enfants atteints de TDAH présentent souvent des modifications spécifiques dans leur ADN, notamment des « Copy Number Variations » (CNV). Ces CNV sont des segments d’ADN qui sont soit manquants, soit en trop, et peuvent influencer le développement du cerveau.
Le TSA : génétique héréditaire ou mutations spontanées ?
Concernant le Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA), l’INSERM indique que, dans de nombreux cas, les altérations génétiques impliquées ne sont pas héréditaires. Le Professeur Arnold Munnich et ses collègues ont d’ailleurs proposé une stratégie diagnostique innovante pour le TSA chez les enfants. Ils se concentrent sur l’observation des gènes les plus fréquemment associés au TSA, en particulier ceux liés à un TSA avec déficit intellectuel. Selon leurs recherches, ces mutations génétiques apparaissent souvent spontanément chez l’enfant (on parle de mutations de novo) et ne sont pas présentes chez les parents.
En cas de mutations de novo, le diagnostic génétique rassure les parents. Le risque de transmission à un futur enfant est faible. La mutation n’est pas dans leur propre patrimoine génétique. Pour les formes familiales de TSA, les mutations sont héritées. Ce même diagnostic informe les parents sur le risque. Ils peuvent ainsi savoir si un second enfant peut développer le même trouble. Cela leur donne des informations essentielles pour leurs décisions.
Coexistence du TSA et du TDA/H ou Cooccurence
Les neurobiologistes reconnaissent l’existence de chevauchements significatifs entre le Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) et le Trouble du Déficit de l’Attention/Hyperactivité (TDA/H). Dans notre famille neuroatypique, nous vivons cette réalité de façon particulièrement palpable. Nos profils divers nous ont poussés à demander une étude de notre génome : mon fils aîné présente des troubles mixtes du neurodéveloppement, ma fille un TDA, et mon dernier un TSA et un TDAH. Quant à moi, des professionnels m’ont diagnostiquée avec un TDA et un autisme léger.
On peut se poser la question, comment se fait-il que deux troubles qui ont l’air opposés se trouvent dans la même personne ? Dans un, il y a un besoin de routine et de l’autre une recherche de nouveauté. Ces deux tendances ont pourtant l’air diamétralement opposées ! Et pourtant, c’est notre réalité au jour le jour. Jongler avec ces deux extrêmes relève parfois de la haute voltige !
Le chevauchement génétique : une explication à la cooccurrence
Au fil de mes recherches, j’ai découvert que la cooccurrence du TDAH et du TSA . Cest-à-dire leur présence simultanée chez une même personne est loin d’être rare. Ce phénomène s’explique en partie par un chevauchement génétique : plusieurs gènes impliqués dans des fonctions cérébrales essentielles semblent jouer un rôle dans les deux troubles.
Parmi ces gènes, on retrouve notamment ceux associés :
- Au développement neuronal et à la formation des synapses, ces connexions indispensables entre les neurones.
- À la régulation des neurotransmetteurs, en particulier la dopamine, très impliquée dans le TDAH, mais également dans certains aspects du TSA, comme la communication sociale et les comportements répétitifs.
- À la réponse immunitaire et inflammatoire du cerveau, une piste de recherche encore émergente, mais prometteuse pour mieux comprendre les deux troubles.
La complexité génétique et ses implications
Il est essentiel de souligner que le TDAH et le TSA sont des troubles complexes, à la fois polyfactoriels (influencés par plusieurs facteurs) et polygéniques (impliquant de nombreux gènes). Il n’existe donc pas de « gène unique » du TDAH ou de l’autisme. Au contraire, de multiples gènes, chacun ayant un petit effet, interagissent entre eux et avec l’environnement pour créer une vulnérabilité.
C’est précisément cette complexité génétique qui explique la grande diversité des profils et des symptômes observés d’une personne à l’autre.
Enfin, ce chevauchement génétique et biologique contribue à expliquer pourquoi le TDAH et le TSA sont souvent comorbides. Autrement dit, les mêmes mécanismes sous-jacents peuvent augmenter la probabilité de développer l’un ou l’autre, voire les deux.
Une meilleure compréhension pour les familles
Les tests génétiques ne sont pas systématiquement proposés, mais ils peuvent représenter un outil précieux pour les familles. En apportant des éléments objectifs, ils permettent de mieux comprendre l’origine des troubles du neurodéveloppement, et ainsi de poser un cadre plus clair autour du vécu de l’enfant… et des parents.
Pour beaucoup d’entre nous, parents, ces tests jouent aussi un rôle libérateur : ils allègent la culpabilité que l’on peut ressentir, souvent à tort. Car oui, on se demande parfois si l’on a « transmis » quelque chose, si c’est « de notre faute ». En réalité, ces troubles sont liés à des facteurs biologiques complexes, sur lesquels nous n’avons aucun contrôle.
Et puis, il faut bien le dire : les résultats scientifiques ont ce pouvoir de faire taire les jugements injustes. Ceux qui affirment, un peu trop vite, que « l’enfant est mal élevé » ou qu’il « manque de discipline ». Ces remarques, bien qu’infondées, peuvent blesser profondément. Avoir des données génétiques tangibles permet de réaffirmer que le TDAH ou le TSA ne sont pas une question d’éducation, mais bien des conditions neurodéveloppementales réelles et légitimes.